Religion totale : Racines et formes du radicalisme puritain

Religion totale : Racines et formes du radicalisme puritain
Quelle est la relation entre la religion monothéiste et la violence ? Cette relation est-elle exclusive, ou existait-elle déjà dans des religions antérieures au monothéisme mosaïque, sous d'autres formes de violence ? Le langage de la violence, qui semble parfois légitime dans les textes sacrés, puise sa légitimité et sa véracité dans la révélation, la foi, et surtout dans l’exclusivité du concept de vérité. Ce phénomène doit être compris avant tout en dehors de toute polémique, justification ou apologétique. Cela est devenu aujourd’hui une nécessité urgente, car notre monde contemporain est entouré d’un niveau sans précédent de violence, dont la référence ultime est Dieu et les textes sacrés. Nous n’avons plus le luxe d’ignorer la question suivante : existe-t-il un lien entre l’exclusivité du monothéisme à l’égard du concept de vérité, et le langage de la violence ? Et comment pouvons-nous analyser et remédier à ce lien ? Au final, Jan Assmann, célèbre égyptologue, ne nous laisse pas seuls face à cette grande interrogation. Il nous propose une vision à la fois pratique et illuminative pour sortir de ce cercle vicieux de la violence.
Assmann avait déjà abordé, dans deux précédents ouvrages ayant provoqué un tollé à leur parution, l’idée des racines de la violence exclusive fondée sur la religion. Il y défendait que l’origine de cette forme de violence réside dans la nature même des religions monothéistes. Le monothéisme repose en effet, dans son essence, sur le principe du monopole de la vérité. Tant qu’il s’agit d’une religion monothéiste, elle rejette naturellement le principe du pluralisme. Il n’y a donc pas de place pour l’autre, car reconnaître l’existence de l’autre, c’est menacer sa propre existence. Cette thèse avait à l’époque suscité une vive polémique, notamment dans les milieux juifs en Allemagne, car Assmann avait abondamment cité la Bible tout au long de son travail. Il n’est donc pas surprenant que le premier livre ait porté le titre : *Moïse l’Égyptien*, et le second : *La distinction mosaïque ou le prix du monothéisme*.
Alors, qu’apporte-t-il de nouveau ici ?
La vérité est que ce qu’il propose est radicalement nouveau. Est-ce un revirement par rapport à ses thèses précédentes, ou simplement une évolution naturelle de sa pensée ? Est-ce une rétractation d’un grand intellectuel sous la pression des cercles dominants dans un pays comme l’Allemagne ? Ou au contraire, une ouverture, une nouvelle illumination ? Dans ce livre, Assmann va encore plus loin — au-delà même de l’Ancien Testament. Il remonte à l’Égypte ancienne, à Babylone, à l’Assyrie, ouvre les livres de mythes, lit les papyri et déchiffre les inscriptions sur les murs des temples. Il explore les religions polythéistes, et non monothéistes. Et là, surprise : il découvre une immense quantité de textes incitant à la combustion, au massacre, à l’extermination de l’autre, des autres. Ainsi, ces textes ne sont pas nés avec la Torah, contrairement à ce qu’il avait avancé dans *Moïse l’Égyptien* et *Le prix du monothéisme*. C’est là la première étape de son livre. Puis, il aborde la question de “l’interprétation” (*herméneutique*) : il examine les textes égyptiens, assyriens, puis bibliques, montrant comment il est possible de les interpréter de manière à en extraire un maximum de potentiel de coexistence entre individus différents. Il démontre ainsi comment cette cohabitation devient envisageable. Assmann distingue dans son analyse plusieurs formes de monothéisme — ou plutôt plusieurs “manifestations” du monothéisme. Car le monothéisme en soi est un, mais ce qui compte, c’est la manière dont on s’y engage, comment on le comprend : telle est la question centrale du livre. Il passe en revue différentes typologies possibles, puis s’arrête longuement sur le monothéisme exclusif et le monothéisme totalisant (*totalitaire*). Dans une partie particulièrement saisissante, il distingue même entre l’unicité de la divinité (*tawhid al-uluhiyya*) et celle de la seigneurie (*tawhid al-rububiyya*), comme s’il s’agissait d’un théologien musulman chevronné. Il pose ensuite la question de la sincérité de notre désir de coexistence.
Et si ce désir est réel, alors quelle est la solution ?
Assmann nous surprend par une réponse non “scientifique”, mais plutôt mystique, illuminative, quasi soufie : il appelle à une coexistence fondée non pas sur l’acceptation passive du statu quo, mais sur une ouverture sincère à la pluralité des voies menant à une même finalité. Le livre cite abondamment l’Ancien Testament, avec une maîtrise remarquable, au point qu’on croirait lire un théologien plutôt qu’un égyptologue. Le traducteur a eu l’excellente initiative de ne pas recourir à la traduction usuelle dite de Van Dyck, mais à la *Bible d’étude*, qui restitue les idées en arabe dans un style clair et précis, loin de la littéralité souvent pesante de la version Van Dyck. Cela permet au lecteur arabe — souvent peu familier avec les Évangiles — de mieux comprendre ce que l’auteur veut dire.
L’ouvrage bénéficie d’une traduction de grande qualité, à la hauteur de sa richesse intellectuelle, signée par l’excellent **Karam El-Nuweyshi**.

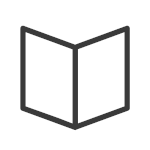



Commentaires :0